À l'origine Puy-Saint-Martin était un village perché typique, bâti principalement sur l'ancien "Podium Sancti Martini" des Romains.
Au cours des siècles, une partie des maisons situées vers le sommet ont été abandonnées, et l'impression de village perché s'est un peu estompée.
Avant de monter au belvédère et de contempler une superbe vue à 180° de la plaine de la Valdaine, laissez-vous conter les grandes étapes de la vie de ce village qui, aujourd'hui, part à la reconquête de ses pentes.
Les origines
Au pied des pentes, en limite de la grande plaine étaient installés plusieurs domaines agricoles gallo-romains. La colline portait-elle un lieu de culte ? Certains le supposent, se basant sur la découverte d'une statue du dieu Mercure (donnée au Musée de Die par l'héritier d'Adèle Clément) que l'on dit provenir du sommet.
Au XVIe siècle, une église dédiée à Saint-Martin est construite sur la colline. La première citation connue du lieu date de 1049, à l'époque où cette "montagne arrondie" est donnée par un chevalier à l'abbaye de Cluny. Le site se composait alors d'un castrum, le Chastelas, d'une église et d'un cimetière.
Du XVIIe au XVe siècle
La "basse-cour", premier regroupement de paysans autour du seigneur, a fait place à un véritable château, cité comme tel en 1336 (castrum Poddi Sancti Martini). Etabli sur le sommet plat de la colline (cimetière actuel), à l'intérieur d'un premier rempart, il deviendra le fief de la famille d'Urre (Eurre) au début du XVe siècle.
Le village se construit dans la pente, en contrebas du château. Près du chemin principal de l'époque qui, par la "Montagne de Roynac"et Autichamp, relie la plaine de Montélimar à la vallée de la Drôme, sont installés le four banal et le moulin à vent ; dans la plaine, un moulin à eau est construit sur le ruisseau de Chacuse.
Puy-Saint-Martin n'est pas un "village fortifié, protégé par d'imprenables murailles". Comme beaucoup de bourgs de la région, il possédait une enceinte, que l'on peut déceler dans la base de certaines hautes maisons du "Portal". À partir du XIVe siècle, ces murailles médiévales, nommées Barries, ont tenu tant bien que mal leur rôle de barrières sanitaires, au temps des épidémies.
Du XVIe au XVIIIe siècle
Les guerres de religion (1562 - 1598) mettent à mal le village et, en 1581, le duc de Mayenne, chargé de la destruction des châteaux appartenant aux seigneurs protestants, constate que le château est dans un état tel qu'il n'y a plus rien à faire pour le démanteler. Le cadastre de 1636 renseigne l'existence du château habité par François d'Urre. Sur ce même document, à l'intérieur des murailles - qui sont peu à peu abandonnées - on dénombre encore une cinquantaine de maisons. Avec les pierres on bâtit "sur les murs" et "hors les murs" de nouvelles maisons, plus grandes que celles de l'époque médiévale : quartiers du Tinal, des Raidis.
Sur le sommet, derrière l'église, subsiste à cette époque une poignée de maisons dans le quartier qui prend le nom de "Barry", peut-être en souvenir du rempart. Vers 1650, François d'Urre fait construire dans le bas du village une nouvelle demeure : le "nouveau château" (mairie actuelle) composé de deux bâtiments reliés par une voûte au-dessus de l'actuelle route menant à Manas (la voûte a été démolie en 1840 pour faciliter le passage des charrettes). L'église du Chastelas étant en très mauvais état, il fait également construire deux chapelles contigües sur la place devant l'église actuelle : la chapelle du seigneur et la chapelle des "pénitents blancs" (confréries de laïcs catholiques soumises à l'autorité de l'évêque, qui se réunissent pour vivre plus intensément leur foi et remplissent également un rôle social). La population ne cesse de s'accroître.
Au début du XVIIIe siècle, le paysage agricole se bouleverse : la superficie consacrée à la vigne diminue et l'olivier disparaît, remplacé par le mûrier. Dans la plaine, de nouvelles terres sont mises en culture.
Du XIXe au XXe siècle
Les artisans et commerçants renforcent leur implantation le long de la nouvelle route (actuelle D6) construite entre 1840 et 1856 qui relie Montélimar et Beaurepaire dans l'Isère. Le bas du village devient définitivement le centre : le temple est terminé en 1854, l'église en 1857, l'école communale en 1895.
Les anciens chemins sont transformés en véritables routes. La population est à son maximum
(1000 habitants en 1840).
Le village perché nommé "le Lieu" se dépeuple. Sur l'emplacement du castrum est construit le cimetière protestant (1855) ; puis le cimetière catholique, situé au bas du village, est transféré pour être réuni au cimetière protestant (1889). Le haut du village disparaît ; les maisons laissent place à des friches parfois transformées en jardins.
A partir de 1914, la population de la commune décroît progressivement pour tomber à 430 habitants en 1968. Elle est actuellement de 877 habitants. Depuis peu, l'asscociation Puy-Saint-Martin Inititatives, en collaboration avec la Mairie et de nombreux bénévoles, a entrepris le défrichage de l'ancien village et le dégagement des vieux murs.
Sources : Paul Vallette, Archives et Patrimoine de Puy-Saint-Martin

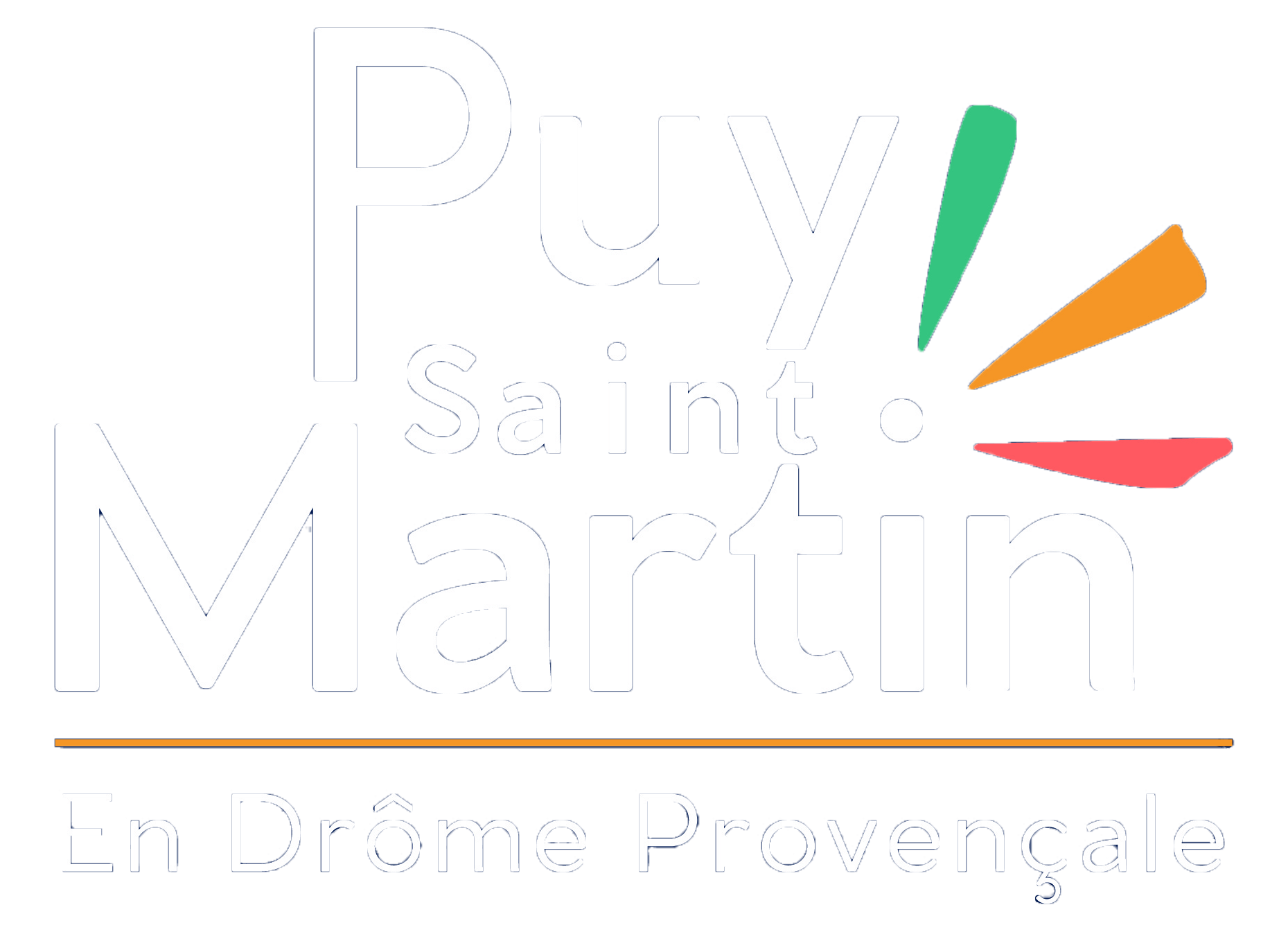
Partager :